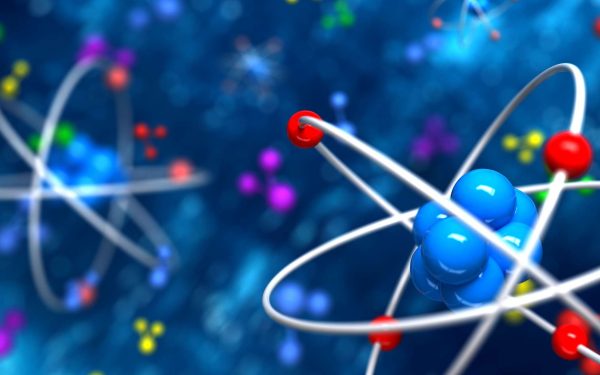 Alors que de plus en plus de pays africains sont tentés par l’énergie nucléaire, considérée comme bas carbone et très peu polluante, certains groupes internationaux, comme Rosatom, CGN et EDF, se positionnent pour accompagner son développement sur le continent.
Alors que de plus en plus de pays africains sont tentés par l’énergie nucléaire, considérée comme bas carbone et très peu polluante, certains groupes internationaux, comme Rosatom, CGN et EDF, se positionnent pour accompagner son développement sur le continent.
On savait que l’Afrique était, grâce à ses conditions météorologiques, le continent du solaire. Les centrales photovoltaïques et thermodynamiques, comme celle de « Noor » au Maroc, mais également les mini-réseaux y émergent depuis quelques années pour produire et acheminer l’électricité dans des endroits non pourvus en énergie. Aux côtés du solaire, dont le développement est à accompagner, l’atome représente lui aussi, si ce n’est une énergie exploitable en l’état, du moins un futur énergétique à envisager sur le continent.
Faible expertise nucléaire
Tandis que l’on assiste aujourd’hui à un regain d’intérêt pour le nucléaire un peu partout dans le monde – après le coup d’arrêt qu’avait provoqué Fukushima en 2011 –, certains pays africains se posent sérieusement la question du recours à cette énergie pour produire de l’électricité. Plusieurs programmes sont ainsi à l’étude et actuellement, une douzaine de réacteurs nucléaires de recherche dans huit pays africains sont sur pieds. Pour l’instant, seule l’Afrique du Sud dispose d’une centrale nucléaire en activité, au nord du Cap, mais le Ghana, le Niger, l’Ouganda, l’Algérie, le Maroc et la Tunisie ont dores et déjà montré leur intérêt pour l’atome.
Comme le résumait l’an dernier l’Agence internationale pour l’énergie atomique (AIEA), en marge d’une conférence sur le rôle du nucléaire en Afrique, « l’énergie étant centrale pour le développement, l’accès à l’énergie est l’un des principaux enjeux des pays africains». Ces derniers, confrontée à une demande énergétique en hausse et soucieux de participer à la lutte contre le réchauffement climatique, réfléchissent à « sécuriser leurs productions d’énergies renouvelables » en incluant l’énergie nucléaire. L’AIEA, de son côté, s’est donnée pour rôle d’assister les Etats africains dans l’évaluation et la construction de projets, « pour un programme nucléaire sûr et durable ».
C’est le cas de l’Afrique du Sud, donc, mais également du Nigéria – première économie africaine – et du Kenya, pays avec lesquels une équipe d’experts de l’agence internationale travaille en étroite collaboration depuis l’an dernier. L’objectif : évaluer puis résoudre les problèmes tout en fournissant des orientations. C’est que, loin d’être anecdotiques, les investissements à réaliser pour mettre en route une centrale nucléaire sont conséquents. Et ce à plus d’un titre. Si le continent africain dispose de 20 % des réserves mondiales d’uranium – métal qui, une fois transformé, devient du combustible pour les réacteurs des centrales –, il dispose pour l’instant d’une très faible expertise nucléaire. La Russie, la Chine, mais également la France faisant office, de ce point de vue-là, de leaders mondiaux.
Troisième génération de réacteurs nucléaires
Moscou, tout d’abord, a en effet misé sur l’atome pour resserrer ses liens – commerciaux, dans un premiers temps, diplomatiques, ensuite – avec les pays africains. Rosatom, l’agence publique russe du nucléaire, a signé cette année des accords de coopération avec le Kenya, l’Ouganda et la Zambie, qui viennent s’ajouter aux conventions précédemment signées avec le Nigéria et le Ghana. Viktor Polikarpov, vice-président Afrique subsaharienne de Rosatom, a déclaré, à l’occasion de la signature des accords de coopération, vouloir créer « un cluster nucléaire avec d’autres compagnies qui pourront collaborer avec nous sur le continent ».
Parmi les pays ayant contracté avec la Russie, l’Ouganda est l’un de ceux dont les projets nucléaires sont les plus avancés. Et pour cause : le pays d’Afrique de l’Est pourrait devenir le prochain producteur d’énergie nucléaire du continent– en concurrence avec l’Egypte et le Nigéria. Un accord bilatéral est en ce moment dans les cartons. Il prévoit la construction de quatre centrales nucléaires dans tout le pays ; soit 3 000 mégawatts (MW) d’électricité pour un investissement de trois milliards de dollars.
La Chine, contrairement à la Russie, ne s’est pas appuyée du nucléaire pour intégrer le marché africain, mais profite de son poids économique pour vendre sa technologie. Au Kenya, le groupe China General Nuclear Power (CGN) a par exemple signé, l’an dernier, avec le Kenya Nuclear Electricity Board (KNEB), un accord pour la construction de la première centrale nucléaire du pays. Pékin devrait ainsi fournir à Nairobi quelque 1 000 MW d’électricité d’ici 2025 – environ 4 000 MW à l’horizon 2030 –, et ce grâce au « Hualong 1» (« Dragon »), le réacteur de troisième génération de conception entièrement chinoise.
« Coopération ancienne entre EDF et Eskom »
La Chine a pris, ces dernières années, une importance considérable sur le marché mondial de l’atome. Au point de faire partie du projet Hinkley Point, dans le sud-ouest de l’Angleterre, où EDF, géant français du nucléaire, doit construire deux réacteurs de type EPR (soit de troisième génération également). Avec Rosatom et CGN, l’électricien français est ainsi l’un des mieux placés pour accompagner les pays africains désireux de se doter de l’énergie atomique. Début novembre, Simone Rossi, directeur exécutif du groupe français chargé de la direction internationale, déclarait d’ailleurs qu’EDF « est prêt à participer à l’appel d’offres » en Afrique du Sud. Pretoria espère en effet construire huit nouveaux réacteurs d’ici 2023 afin de produire 9 600 MW supplémentaires.
Pour Pascal Colombani, envoyé spécial de la France sur le nucléaire, en déplacement en Afrique du Sud en juin dernier, Paris a plusieurs atouts à faire valoir. Outre « la coopération très ancienne entre EDF et Eskom sur Koeberg », l’Hexagone ayant construit la première – et seule à ce jour – centrale nucléaire du continent dans les années 1980, le groupe français peut faire valoir sa « technologie, qui […] est la plus avancée au point de vue sécurité », d’après M. Colombani. Et pour cause. Afin de prolonger la durée de vie de ses 58 réacteurs, EDF est en plein lifting de son parc nucléaire français. Le but ? Renforcer la sûreté de ces installations, entre autres.
L’Autorité de sûreté nucléaire, le gendarme français du nucléaire, vient d’ailleurs de rendre un avis favorable à l’électricien après qu’une anomalie a été détectée sur les générateurs de vapeurs de plusieurs de ses unités. Résultat : sept réacteurs reprendront prochainement du service. Si la décision permettra à la France de ne pas passer l’hiver au froid, pas sûr qu’elle joue pour autant sur les (futurs) appels d’offres africains. Une chose, en revanche, fait davantage consensus : l’avenir énergétique de l’Afrique, outre les énergies vertes, devrait passer par le nucléaire.
Ludovic Maréchal


