Chef du Département du développement économique, de l’intégration et du commerce à la Commission de l’Union africaine après avoir été Directeur du Département des Affaires Économiques de la Commission de l’Union africaine, Dr Jean Denis Gabikini vient de publier un livre qui cadre bien avec l’actualité africaine . Intitulé « African Financial Ecosystem / Towards an African Common Currency », cet essai est enrichi par l’expérience d’un haut cadre habitué aux grandes missions. Avant son poste actuel, Dr Jean-Denis a travaillé pendant 10 ans comme conseiller au Cabinet sous trois Présidents, à savoir le Pr Alpha Oumar Konaré, Dr Jean Ping et Dr Nkosazana Dlamini-Zuma. Né au Congo Brazzaville, Dr Gabikini est détenteur d’un Doctorat en administration des affaires internationales ainsi que d’un MBA en finance internationales et un MSc en Relations économies internationales obtenus au Canada. Dans cet entretien, il est question du livre et de sa thématique principale portant sur l’écosystème financier africain et l’objectif ultime de parvenir, dans un délai raisonnable, à une union monétaire et à une monnaie africaine commune.
Vous venez de publier un livre sur l’écosystème financier africain intitulé Vers une monnaie commune africaine, édité à New York par Austin Macauley Publishers. Pourriez-vous brièvement nous résumer les grandes lignes de votre réflexion ?
Le Traité d’Abuja, signé en 1991 par les États membres de l’Organisation de l’unité africaine (OUA), a défini clairement l’objectif de réaliser l’intégration monétaire sur le continent africain. En vertu de son article 6, les modalités de création de la Communauté économique africaine (CEA) prévoyaient sa mise en œuvre progressive en six (6) étapes de durée variable sur une période ne dépassant pas trente-quatre (34) ans. À chaque étape, des activités spécifiques sont assignées et mises en œuvre simultanément. La sixième étape qui doit être mise en œuvre dans un délai ne dépassant pas cinq (5) ans suggérait (i) l’intégration de tous les secteurs, à savoir économique, politique, social et culturel; la création d’un marché intérieur unique et d’une Union économique et monétaire panafricaine. Il suggérait également (ii) la mise en œuvre de la phase finale pour la création d’une Union monétaire africaine, la création d’une Banque centrale africaine unique et la création d’une monnaie africaine unique.
Le Traité visait à établir une monnaie africaine unique, à harmoniser les politiques monétaires et budgétaires et à mettre en place une banque centrale commune. La Banque Centrale Africaine (BCA), qui s’inscrit dans la vision de l’Agenda 2063, devrait voir le jour d’ici 2034. Son rôle est de développer une politique monétaire commune et une monnaie unique africaine » comme moyen « d’accélérer l’intégration économique telle qu’envisagée dans les articles 6 et 44 du Traité d’Abuja. Après plus de trente ans de son existence, il était temps de questionner la mise en œuvre du Traité d’Abuja et, surtout, ses objectifs d’une Union économique et monétaire panafricaine avec pour but ultime la création d’une Banque centrale africaine et d’une monnaie africaine commune.
La question monétaire suscite aujourd’hui un débat sur le continent. Dites-nous, que représente la monnaie dans l’écosystème financier de l’Afrique en particulier et dans une économie moderne en général ?
L’intégration monétaire en Afrique est un phénomène singulier, qui s’explique par divers facteurs tels que le colonialisme, les idéologies eurocentristes, les disparités économiques, l’instabilité politique et financière et l’inefficacité des cadres réglementaires, entre autres. Les différentes tentatives d’intégration monétaire en Afrique peuvent être attribuées au besoin de développement économique, à la facilitation du commerce intra-africain, à l’appel au renforcement de l’intégration régionale et aux désirs de stabilité financière sur le continent.
Cependant, une rétrospective de l’utilisation de la monnaie sur le continent met en évidence trois périodes, la phase précoloniale marquée par l’utilisation de quelques biens de référence, une phase coloniale marquant le début des unions monétaires avec des intérêts métropolitains et une phase postcoloniale avec l’histoire éphémère de la livre ouest-africaine et du shilling est-africain. En effet, avant l’époque coloniale, il existait un ensemble d’éléments qui répondraient parfaitement à la définition contemporaine de la monnaie, à savoir, selon la philosophe française Yaël Dosquet , « Une marchandise, utilisée comme moyen de paiement d’une autre marchandise est considérée comme monnaie, si elle peut être échangée directement contre toute autre marchandise présente dans un système d’échange.
Deux rôles sont ainsi attribués à la monnaie : un rôle économique et un rôle social ». L’Afrique précoloniale a connu un certain nombre de biens qui répondaient à cette caractéristique de commodité échangeable à travers des zones géographiques bien précises où étaient utilisés des biens tels que les cauris en Afrique de l’Ouest, ou les pièces métalliques en or, argent ou cuivre en Afrique du Nord. Ces biens étaient utilisés en raison de leur rareté et de leur durabilité, et il faut noter que ces moyens de paiement étaient principalement utilisés entre différents peuples, d’où l’on peut déceler une idée de facilitation des échanges et même d’intégration entre empires ou peuple d’Afrique, d’où l’idée précoloniale d’une union monétaire en Afrique.
Qu’est-ce qui vous a principalement motivé à écrire sur le thème de la monnaie commune africaine ?
Historiquement et contextuellement, divers modèles d’intégration ont été expérimentés par les puissances coloniales, mais ces systèmes se sont largement effondrés après l’indépendance. Par exemple, les Français ont tenté de maintenir la cohésion mais ont donné la priorité à leurs propres intérêts, ce qui a conduit à la fragmentation entre deux régions francophones de l’Ouest et du Centre du continent. Les efforts en Afrique de l’Est avec le shilling est-africain et de l’Ouest, ou encore la livre ouest-africaine, ont également échoué, chaque nation poursuivant son propre programme sans volonté politique unifiée. L’Afrique du Sud a fait une tentative notable, mais l’intégration n’a jamais eu lieu ; elle aurait nécessité une approche différente, comme l’adoption d’une monnaie de la SADC.
La trajectoire de l’intégration régionale s’est accélérée en avril 2018 lorsque les chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine ont approuvé à l’unanimité la création de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) effective depuis le 1er janvier 2021. Les efforts récents des pays de l’AES et la nouvelle monnaie du Zimbabwe insufflent une nouvelle dynamique à cet écosystème. Parallèlement, l’essor des nouvelles technologies présente à la fois des défis et des opportunités pour l’intégration financière. Les organisations publiques et les institutions panafricaines jouent un rôle crucial dans ce parcours, où la dimension politique a une influence significative.
En outre, la dynamique internationale, illustrée par des initiatives comme celles des BRIC, influence encore davantage le paysage. Ces éléments pris ensemble créent une perspective intrigante, servant de base à la motivation qui a façonné cette discussion sur l’écosystème africain et inspiré une réflexion sur des solutions plausibles.
Dans votre livre vous pointer du doigts les échecs de tentatives d’intégration monétaire depuis la colonisation et après la colonisation. Dites-nous qu’est-ce qui est à la base de l’effondrement de toutes démarches que vous décrivez ?
Comme je l’ai dit plus haut, historiquement et contextuellement, divers modèles d’intégration ont été expérimentés par les puissances coloniales, mais ces systèmes se sont largement effondrés après l’indépendance. Par exemple, les Français ont tenté de maintenir la cohésion mais ont donné la priorité à leurs propres intérêts, ce qui a conduit à la fragmentation entre deux régions francophones de l’Ouest et du Centre du continent. Dans des colonies anglaises d’Afrique de l’Ouest, la monnaie avait précédé le West African Currency Board (WACB) et c’est ce WACB qui a servi de précédent pour l’Afrique de l’Est sous domination anglaise.
Ainsi, dans sa volonté de contrer l’utilisation du manille dans les colonies anglaises d’Afrique de l’Ouest et de faciliter l’introduction du commerce, la livre ouest-africaine (West African Pound) a été introduite à parité égale avec la livre anglaise à partir de 1907. Dans le contexte ouest-africain, la WACB avait émis une monnaie commune dans les colonies britanniques d’Afrique de l’Ouest de 1912 à 1962. Il faut noter que le Liberia, bien qu’indépendant, faisait également partie du comité monétaire ouest-africain à partir de 1907, remplaçant le dollar libérien jusqu’en 1943.
De plus, les parties anglaises du Togoland (Togo) et du Kamerun (Cameroun), anciennes colonies allemandes partagées entre la France et l’Allemagne, utilisaient la livre ouest-africaine jusqu’à l’indépendance. La WACB devint indépendante et devint ainsi des États souverains. Le Ghana, première colonie anglaise d’Afrique de l’Ouest à obtenir son indépendance en 1957, sortit de la WACB en 1958. Le Nigéria, qui disposait déjà d’une banque centrale en 1959, sortit également de la WACB avant son indépendance en 1960. Seules les deux anciennes colonies plus petites, la Gambie et la Sierra Leone, restèrent liées au comité monétaire bien après l’indépendance. La Sierra Leone demeura membre jusqu’à la création de sa propre monnaie en 1964. Seule la Gambie resta au sein du comité monétaire, qui a été rebaptisé conseil monétaire de la Gambie jusqu’en 1971, date à laquelle la Gambie a créé sa propre monnaie.
En Afrique de l’Est, l’émission du shilling est-africain débuta en 1921 suite à la création de l’East African Currency Board (EACB). Dans son périmètre, l’EACB était chargée de frapper les pièces de monnaie, d’imprimer les billets de banque et de fixer les valeurs nominales des billets et des pièces de monnaie. Dans le contexte de l’Afrique de l’Est, l’introduction de la monnaie commune ne se fit pas sans difficultés. En effet, l’émission du shilling est-africain se trouva confrontée à l’habitude d’utiliser la roupie indienne dans les colonies du Kenya et de l’Ouganda, qui étaient fortement liées par le commerce à l’Inde britannique. Par conséquent, il circula parallèlement à la nouvelle monnaie et la couronne britannique dut retirer progressivement cette monnaie des colonies.
Dans le cas du Tanganyika, intégré en 1936, une difficulté similaire surgit avec l’utilisation du mark, qui perdura malgré la tutelle exercée sur ce territoire par le Royaume britannique. Il faut aussi ajouter qu’à un moment donné, les territoires représentés par le currency board ont dépassé ces trois territoires et ont inclus l’Ethiopie, la Somalie britannique et italienne, ainsi qu’Aden, qui a vu de fait l’utilisation du shilling est-africain dans leurs pays notamment pendant la période de la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 1950, la EACB sentant les changements de perspective, a commencé à se transformer en une véritable banque centrale et ne s’est plus limitée au rôle de simple changeur de monnaie. Dans les limites fixées par le Secrétaire d’Etat, la EACB a ainsi été autorisée à accorder des crédits aux gouvernements des territoires constitutifs en détenant des titres d’Etat ou garantis par l’Etat. En 1960, la EACB a connu une forme d’africanisation, avec l’indépendance des Etats qui était sur le point d’être accordée.
Ainsi, le siège a été transféré de Londres à Nairobi. Avec l’indépendance, les territoires du Tanganyika en 1961 fusionnent avec Zanzibar en 1964 pour former la Tanzanie, puis la formation de l’Ouganda en 1962 puis la formation du Kenya en 1963. Le shilling est-africain reste au sein du currency board qui se transforme en banque centrale commune à ces États indépendants et sa parité fixe reste avec la livre sterling jusqu’en 1965. À partir de 1965, les États désormais indépendants décident d’abandonner le currency board et de battre monnaie seuls. Ainsi en 1966, le shilling est-africain cesse d’exister, laissant la place au shilling kenyan, au shilling tanzanien et au shilling ougandais. Les efforts en Afrique de l’Est et de l’Ouest furent ainsi des échecs, chaque nation poursuivant son propre programme sans volonté politique unifiée.
Par conséquent, lorsqu’on les analyse en profondeur, elles auraient pu connaître un sort similaire aux unions monétaires du franc CFA. En effet, ces deux ensembles monétaires ont été créées à l’origine pour assurer la circulation d’une monnaie commune dans les colonies anglaises d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique de l’Est. Les monnaies étaient fortement liées à la monnaie coloniale, la livre sterling. Contrairement à la zone franc CFA, unique à ses débuts, les deux ensembles monétaires sous domination coloniale britannique étaient complètement différentes et autonomes dès l’origine, ayant connu des dates de création différentes. Elles visaient donc à unifier monétairement des colonies qui étaient administrées séparément même si elles faisaient partie de vastes ensembles sous régionaux africains. Outre les zones susmentionnées, il existait une union monétaire relativement petite, à savoir la Zone monétaire commune (CMA), qui est une union monétaire de la région de l’Afrique australe, composée de quatre pays, à savoir le Lesotho, la Namibie, l’Afrique du Sud et le Swaziland (aujourd’hui Eswatini). La CMA est une alliée de l’Union douanière d’Afrique australe (SACU).
Parmi les membres de la SACU, seul le Botswana est actuellement sorti de la CMA. En 1976, le Botswana a remplacé le rand par le pula en vue de mettre en œuvre sa propre politique monétaire. Bien que la CMA ait pu apporter des avantages économiques relativement appropriés à ses membres, elle n’a pas été exempte de critiques concernant ses pratiques et ses politiques. Tout d’abord, la zone monétaire a été critiquée à propos de la domination de l’Afrique du Sud sur les trois plus petits pays. L’argument est que la domination de l’Afrique du Sud offre une autonomie politique limitée aux trois autres pays. Considérant cela, le rand sud-africain est la monnaie courante dans tous les pays. Le Lesotho, l’Eswatini et la Namibie sont essentiellement contraints par les décisions de politique monétaire et de réglementation prises par la Banque de réserve sud-africaine. Une telle situation peut être problématique en raison des disparités qui existent au sein des trois autres petits pays, qui pourraient ne pas être à la hauteur des besoins économiques et des exigences monétaires de l’Afrique du Sud.
Deuxièmement, découlant de la première critique de la domination de l’Afrique du Sud, certains soutiennent que la CMA est confrontée à une redistribution inégale des ressources. L’Afrique du Sud ayant le plus grand écosystème économique et financier le plus avancé, les avantages escomptés sont les plus ressentis par l’économie sud-africaine. Il y a donc eu plusieurs appels à une redistribution des avantages. Enfin, il y a la critique du manque de participation démocratique, car le processus de prise de décision n’est pas convoqué par des élus. Les décisions sont souvent prises par des responsables non élus des banques centrales. Cela entraîne donc un manque de participation des acteurs clés tels que les citoyens et les parties prenantes aux décisions qui les affectent et qui affectent l’économie. Ces critiques soulignent la nécessité d’un développement et de réformes continus afin de garantir que l’union monétaire réponde aux besoins et aux demandes de tous ses États membres. A côté des États de la zone franc et de la CMA, qui sont les seuls à former une union monétaire, tous les autres États membres de l’Union africaine ont leur propre monnaie.
Vous avez suivi en votre qualité d’économiste au sein de la commission de l’Union africaine le processus de mise en œuvre de l’ECO dans la zone CEDEAO avec une échéance fixée à l’époque à 2020. Cette échéance fut reportée pour 2027. Quels sont selon vous les pesanteurs qui ont contribué à ce report ?
Fin 2019, le franc CFA ouest-africain a annoncé son appel à une éco-monnaie, en réponse aux critiques d’une volonté de s’inscrire dans une monnaie ouest-africaine plus globale. L’Eco est censée faire office de dénomination de la monnaie franc CFA, qui avait été souhaitée par toute la CEDEAO. De plus, annoncées conjointement par le président de la Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara et celui de la France, Emmanuel Macron, un certain nombre de réformes intéressantes ont été envisagées. D’abord l’abandon de l’appellation franc CFA, avec un acronyme qui date de la colonisation et cristallise le débat politique. Ensuite, la fin de la présence de représentants français au conseil d’administration et la fin du compte d’exploitation. Ces réformes n’ont pas eu le temps d’être mises en œuvre en raison de la crise du covid-19.
Il y a aussi un appel aux États membres de la ZMAO (Zone Monétaire Ouest Africaine) qui regroupe les États non membres de l’UEMOA pour la création de la monnaie unique ouest-africaine. La réforme précitée peut être vue comme une extension déguisée de la zone franc CFA actuelle, qui mettrait en péril le projet de monnaie unique Eco de la CEDEAO. Pour la zone CFA d’Afrique centrale, si une telle réforme devait être mise en œuvre, elle pourrait créer une impulsion positive vers une monnaie unique d’Afrique centrale dans la perspective du Traité d’Abuja et de l’Agenda 2063.
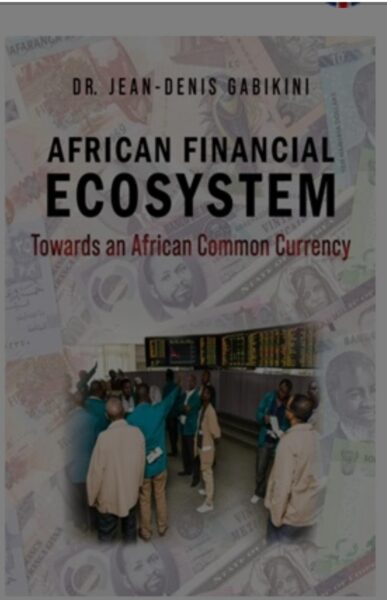
En tant qu’économiste comment analysez-vous le débat sur le franc Cfa ? Cette zone monétaire résistera-t-elle aux désirs de souveraineté monétaire qui gagne certains pays regroupés au sein de l’AES ?
La première des critiques formulées à l’égard du Franc CFA, nonobstant son caractère intégrateur pour de nombreux Etats francophones, porte sur l’ordre symbolique et politique, qui affecte la gouvernance et la gestion des banques centrales et crée un lien fort avec la France aujourd’hui (à travers l’euro). En effet, le Franc CFA est critiqué pour la présence et le droit de décision conféré aux autorités françaises dans la conduite de la politique monétaire des deux banques centrales concernées. Au-delà, le compte d’opérations, qui garantit la convertibilité illimitée du Franc CFA en euro et prévient les défauts de paiement au sein de la zone CFA, oblige cependant toujours les Etats concernés (ceux de la BEAC) à déposer 50% de leurs devises étrangères à la Banque de France. Un pourcentage qui était à 65% jusqu’en 2007. Cette obligation a cependant changé et ne s’applique plus à la zone UEMOA suite au nouvel accord de décembre 2019.
La deuxième critique est d’ordre économique au regard de la politique de change menée par les zones concernées et du but poursuivi par ces unions monétaires. Elle est critiquée par de nombreux experts, dont Kako Nubukpo, qui critique l’arrimage du Franc CFA à l’euro avec un taux de change fixe. Certains vont jusqu’à qualifier le Franc CFA de sous-monnaie de l’euro. Le Franc CFA, en effet, est une monnaie non reconnue et inconvertible en réalité avec d’autres monnaies internationales comme le dollar. De plus, les banques centrales, accusées de s’aligner sur la BCE, ont pour principale préoccupation la lutte contre l’inflation plus que l’objectif de croissance pour les zones concernées.
Enfin, la troisième critique concerne la pertinence de l’intégration monétaire sans une réelle intégration économique mondiale et des facteurs de production. Ainsi, affirme Kako Nubukpo, « L’expérience de l’intégration monétaire dans la zone UMOA/UEMOA est atypique, dans la mesure où l’instauration d’une monnaie commune, le franc CFA, a précédé la mise en place des conditions économiques de sa pérennité, notamment l’effectivité des règles édictées en matière de convergence et de bonne gestion macroéconomique ». Pour l’auteur, la monnaie commune franc CFA ne pouvait pas jouer ce rôle de lien entre les économies concernées au regard de l’extraversion de leurs économies, tournées fortement vers l’exportation des matières premières. Tout ceci conduit à la nécessité d’un changement de paradigme au sein de ces espaces, même si ces critiques sont pertinentes, notamment sur la perspective d’une intégration économique globale.
Les auteurs reconnaissent cependant que ce débat est un faux débat car la seule solution est l’accélération du processus de mise en œuvre des institutions financières africaines avec comme ultime objectif la création d’une monnaie commune africaine qui, in fine, permettra au francs CFA de mourir de ses propres contradictions. Par ailleurs, pour la première fois en quarante-neuf ans d’histoire, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), composée de quinze pays membres, a assisté au départ de quatre de ses membres fondateurs. Le dimanche 28 janvier 2024, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont annoncé leur retrait immédiat de l’organisation régionale par le biais d’un communiqué de presse conjoint. Les trois pays ont invoqué l’imposition de sanctions qu’ils jugent « illégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables » par l’organisme régional comme raison de leur décision, affirmant que la CEDEAO était devenue une menace pour ses États membres et ses populations. De nombreux analystes et commentateurs des médias ont exprimé leur inquiétude quant au fait que le retrait de ces trois pays compromet les réalisations de la CEDEAO au fil des ans. Ces réalisations comprennent la facilitation de la libre circulation des citoyens et des biens grâce à un passeport commun de la CEDEAO, ainsi que des projets d’infrastructures régionales, dont beaucoup sont en cours ou déjà achevés. Les critiques soulignent également le risque de tensions au sein des communautés dont les populations de ces pays résident dans d’autres États membres de la CEDEAO, et vice-versa.
D’un autre côté, les partisans du retrait soutiennent qu’il s’agit d’une décision mûrement réfléchie qui s’aligne sur le désir de « souveraineté totale des peuples », tel qu’exprimé par Appolinaire Joachimson Kyelem de Tambela, le Premier ministre du Burkina Faso. En outre, les partisans notent que ces pays auront désormais la liberté de négocier des accords bilatéraux de manière indépendante avec d’autres États membres de la CEDEAO avec lesquels ils partagent des liens économiques et diplomatiques forts, comme le Togo et le Bénin. Le cas de la Mauritanie, qui s’est retirée de la CEDEAO en 2000 et a ensuite rejoint l’organisation en tant que membre associé en 2017, sert de précédent. Malgré son retour au bercail, la Mauritanie reste un membre non à part entière de la CEDEAO. Le 16 septembre 2023, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont annoncé la signature de la Charte du Liptako-Gourma, créant ainsi l’Alliance des États du Sahel (AES).
Cette alliance vise à unir leurs efforts pour parvenir à la pleine souveraineté, exercer l’autonomie nationale et lutter contre le terrorisme à travers un cadre de défense commun. Les objectifs affichés de l’AES vont au-delà de la sécurité, les trois pays signataires ayant exprimé leur aspiration à favoriser l’indépendance, la dignité et l’autonomie économique. Cette évolution a suscité des débats sur la nécessité pour ces pays de se retirer de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), une organisation composée de huit États membres de la CEDEAO qui partagent une monnaie commune, le franc CFA. Un tel retrait entraînerait la création de leur propre monnaie. De nombreux analystes considèrent qu’il s’agit d’une considération importante, conforme aux aspirations de ces trois pays et à l’évolution de la dynamique au sein de la sous-région. Malgré les critiques et les inquiétudes concernant la déstabilisation potentielle de la CEDEAO et ses ramifications associées, il est évident que ces pays s’alignent sur les objectifs énoncés dans le Traité d’Abuja. Ce traité définit le cadre de l’intégration continentale africaine, y compris le rôle futur des huit communautés économiques régionales (CER) reconnues par l’Union africaine, dont la CEDEAO est un membre éminent.
Le Traité d’Abuja, lancé en 1991, pose les bases de la création d’une communauté économique africaine entre les nations participantes sur une période de 34 ans. Selon l’article 4, qui décrit les objectifs de la Communauté africaine, le paragraphe 2 (d) souligne l’objectif de favoriser la libéralisation du commerce en éliminant les droits de douane et les barrières non tarifaires entre les États membres. Cet objectif envisage la création de zones de libre-échange au sein de chaque communauté économique régionale, conduisant à terme à la formation d’une union douanière/marché commun continental avec des tarifs extérieurs communs. Cependant, la trajectoire de l’intégration régionale s’est accélérée en avril 2018 lorsque les chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine ont approuvé à l’unanimité la création de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), dépassant le calendrier fixé par le traité d’Abuja. Alors que certaines communautés économiques régionales (CER) telles que la CEDEAO, la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) et le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) avaient déjà progressé vers la formation de zones de libre-échange régionales, d’autres ont été prises au dépourvu par l’arrivée de la ZLECA.
À ce jour, 47 des 55 États membres de l’Union africaine ont ratifié le traité de la ZLECA, dont le lancement officiel a eu lieu le 1er janvier 2021. Couvrant les 55 États membres, la ZLECA constitue la plus grande zone de libre-échange au monde depuis la création de l’Organisation mondiale du commerce, englobant un marché de 1,4 milliard de personnes et un produit intérieur brut (PIB) totalisant 2,5 billions de dollars. Malgré les récentes annonces de retrait de la CEDEAO par trois pays, l’impact global devrait être minime, étant donné que douze des quinze pays membres de la CEDEAO ont ratifié le traité de la ZLECA. Notamment, deux des pays déclarant leur intention de quitter la CEDEAO, le Mali (2019) et le Niger (2019) sont les seuls membres de la Communauté à avoir ratifié et déposé les instruments du Protocole au Traité d’Abuja relatif à la mise en œuvre progressive de la libre circulation des personnes, du droit de résidence et du droit d’établissement. Toutefois, ce Protocole, ratifié à ce jour par seulement quatre pays, dont le Rwanda (2018) et Sao Tomé & Principe (2019), attend la ratification et le dépôt des instruments par quinze pays avant d’entrer en vigueur.
En conclusion, la mise en œuvre effective de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) et de ses instruments associés, notamment ceux de la première phase comprenant les protocoles sur le commerce des biens, le commerce des services, ainsi que le mécanisme de règlement des différends, et ceux de la deuxième phase concernant les protocoles sur les investissements, les droits de propriété intellectuelle, la concurrence et le commerce numérique, couplée à l’entrée en vigueur du Protocole au Traité d’Abuja relatif à la réalisation progressive de la libre circulation des personnes, du droit de résidence et du droit d’établissement, pose la question de la sortie potentielle des pays de l’AES de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). La résolution de ce débat dépend de l’engagement de ces pays dans l’Agenda d’intégration continentale. Quant à savoir si ces trois pays devraient quitter l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), qui regroupe huit États membres de la CEDEAO partageant la monnaie commune du franc CFA, les avis divergent. Les économistes, juristes et experts de l’UEMOA soutiennent que ces pays doivent adhérer aux traités qui régissent l’organisation, à savoir : le Traité sur l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA) et le Traité UEMOA amendé. Selon l’article 3 du Traité UMOA, les États membres s’engagent, sous peine d’exclusion, à respecter ses dispositions, le Traité UEMOA et les textes d’application.
Par ailleurs, l’article 103 du Traité UEMOA révisé précise les conditions d’adhésion des États membres. Ils estiment qu’il est peu probable que la Conférence des chefs d’État de l’UEMOA permette à trois pays d’adhérer sélectivement à certaines réglementations tout en bénéficiant d’autres privilèges, notamment en matière douanière. Cependant, après l’annonce de leur retrait de la CEDEAO, les dirigeants de l’Alliance des États du Sahel (AES) ont ouvertement discuté de l’abandon du franc CFA et de la création de leur propre monnaie. Néanmoins, ils devraient reconnaître que la création monétaire nécessite des réserves de change importantes pour assurer la stabilité, des infrastructures pour la frappe de la monnaie et des investissements pour moderniser les systèmes de paiement, ressources qui manquent actuellement à ces pays, malgré leur potentiel minier important. Quant aux acquis de base en terme de ressources, le Mali dispose par exemple de ressources naturelles importantes, dont près d’un million de kilomètres carrés de bassins sédimentaires, d’importants gisements de gaz et d’uranium, de plus de 2 milliards de tonnes de réserves de minerai de fer, de réserves de bauxite estimées à 1,2 milliard de tonnes et de réserves de manganèse supérieures à 20 millions de tonnes.
Avec 45,9 tonnes d’or produites, les exportations d’or ont généré 856,9 milliards de FCFA, consolidant le Mali comme le troisième producteur africain de ce métal précieux, après l’Afrique du Sud et le Ghana. Le Niger, quant à lui, dispose d’environ 150 indices minéraux, avec des gisements identifiés sur son vaste territoire national couvrant 1 267 000 km². Notamment, d’importantes réserves d’uranium se trouvent dans le massif de l’Aïr, aux côtés des phosphates, de l’or dans la région nigérienne du Liptako, du charbon à Anou-Araren et de l’étain à El Micky. Le Niger se classe au troisième rang mondial en matière de production d’uranium, représentant 70 % des exportations du pays, derrière le Canada et l’Australie. Au Burkina Faso, plus de 70 000 km² de formations volcano-sédimentaires abritent une pléthore de ressources minérales potentielles. Les principales ressources du pays comprennent l’or, le cuivre, le zinc, le manganèse, le phosphate et le calcaire, avec également des occurrences de diamant, de bauxite, de nickel et de vanadium. Le 15 février 2024, plusieurs ministres de l’Alliance des États du Sahel (AES) se sont réunis à Ouagadougou, convenant d’entamer des consultations techniques visant à définir un cadre juridique et institutionnel pour un éventuel traité de confédération. Si les dirigeants de ces nations s’engagent collectivement dans des programmes d’industrialisation innovants et dans la transformation locale des matières premières au sein de la confédération, ils peuvent utiliser leurs réserves de ressources comme garantie. En outre, une attractivité accrue pour les investissements extérieurs et la capacité à lever des fonds sur les marchés internationaux contribueront à la stabilité à long terme de leur future monnaie.
Par où l’Afrique doit-elle commencée dans sa marche vers la création d’une monnaie commune. Est-ce par une union monétaire ou directement par la création de la monnaie commune au regard de l’agenda 2063 ?
Le Plan d’action de Lagos à son chapitre VII au point B traite plus spécifiquement de l’aspiration financière africaine. Une aspiration qui prévoit la « Restructuration et réorientation complète des programmes et politiques des institutions monétaires et financières pré et postcoloniaux importés en Afrique, afin de mieux les adapter et les intégrer dans les objectifs de développement régional et au-delà, de chaque pays du continent ». Au niveau sous-régional, il a été demandé que : « chaque sous-région étudie les accords de coopération financière existants entre les États membres en vue de les fusionner dans un système multilatéral sous régional de compensation et de paiement, et que, dans le cas des sous-régions où il n’existe pas encore d’accords institutionnels de paiements, les États membres entament des négociations sur les accords de compensation et de paiement et sur la création de zones commerciales préférentielles».
Au niveau continental, il a été demandé que soit créé un « Fonds monétaire africain ainsi qu’un Fonds africain de garantie mutuelle et de solidarité ». En somme, le Plan d’action de Lagos vise en quelque sorte la convergence en matière monétaire tant au niveau des sous-régions africaines qu’au niveau des régions africaines, sans pour autant évoquer l’idée d’une monnaie africaine unique, que ce soit au niveau régional ou continental. La question de la réforme des unions monétaires coloniales (dite « Zone Franc »), qui comprennent l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), également appelée « Zone Franc », a nécessité une capitalisation méthodique des progrès réalisés en matière de stabilité macroéconomique et de facilitation des échanges, pour aboutir à une réforme stratégique et maîtrisée qui les dissoudrait dans le processus de mise en place de la zone monétaire africaine. Cela implique d’intégrer un processus de régionalisation panafricain, en transférant les unions existantes vers des Communautés économiques régionales (CER) reconnues, telles que la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) pour la CEMAC et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour l’UEMOA.
L’alignement des systèmes de convergence sur les critères de convergence de l’Association des banques centrales africaines (ABCA) devrait précéder l’intégration de ces unions monétaires régionales dans la zone monétaire africaine envisagée. Pour répondre au besoin de transformation structurelle et de développement productif en Afrique, il est important d’accélérer la mise en place d’institutions financières africaines et l’intégration financière et monétaire. Cela permettra de renforcer l’utilisation des innovations technologiques et d’accélérer la mise en œuvre de l’Accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA). Pour permettre aux institutions financières africaines de financer les flux commerciaux et d’investissements intra-africains, les Communautés économiques régionales devraient aider les États membres à mobiliser des ressources nationales.
À cette fin, les institutions financières régionales africaines devraient renforcer les politiques de lutte contre les flux financiers illicites (FFI), réformer les politiques fiscales et explorer des sources innovantes telles que les fonds de pension, les fonds souverains, les partenariats public-privé et les fonds de la diaspora, qui ont un réel potentiel de capitalisation en Afrique. La digitalisation croissante des systèmes de paiement pose aux institutions financières africaines le défi de sécuriser ces nouveaux modes de paiement, tout en facilitant les échanges commerciaux. Il en va de même pour l’émergence de nouvelles formes de monnaies virtuelles, caractérisées par leur manque d’institutionnalisation et leur risque élevé de volatilité.
Afin de capitaliser sur ces nouvelles formes de monnaie, il est recommandé aux institutions financières régionales africaines de s’approprier le débat sur les enjeux pour le continent, afin de parvenir à un consensus sur un encadrement juridique de ces nouvelles formes de paiement. Les perspectives de coopération entre l’Afrique et les pays BRICS offrent des avantages en termes d’amélioration du capital humain et physique, notamment dans le domaine de l’ingénierie, de la science et du transfert de technologie. Cependant, le projet de monnaie unique des BRICS, ainsi que l’adhésion des pays africains, devraient avant tout prendre en compte l’agenda de l’intégration régionale africaine, notamment dans les domaines financier et monétaire. En ce qui concerne la création d’une Union monétaire africaine, une approche progressive est recommandée, en commençant par des zones monétaires régionales au sein des Communautés économiques régionales (CER) reconnues par l’UA. Cette approche prend en compte les caractéristiques spécifiques de chaque CER et permet de relever les défis tels que les politiques budgétaires incohérentes et les secteurs financiers inefficaces, avant de progresser vers une zone monétaire à l’échelle du continent.
Vous avez été directeur p.i. du Département des affaires économiques et actuellement Chef du Département Intégration et Commerce au sein de la Commission de l’Union Africaine en charge, entre autres, du processus de mise en œuvre des instruments monétaires africains prévus dans le traité de Syrte à savoir le Fonds monétaire africain, la banque centrale africaine, la bourse africaine des matières premières …Pourquoi à ce jour ces institutions tardent t-elles à être mise en place ?
Le Traité d’Abuja stipule que la Communauté économique africaine (CEA) doit être établie en six (6) étapes, la dernière étant consacrée, entre autres, à la mise en œuvre de l’étape finale pour la création d’une Union monétaire africaine, la création d’une Banque centrale africaine (BCA) et la création d’une monnaie africaine unique. Dès 1999, dans la Déclaration de Syrte, les chefs d’État et de gouvernement de l’UA ont appelé à la mise en place rapide de toutes les institutions proposées dans le Traité d’Abuja et ont pris des décisions importantes concernant les pays hôtes du siège de ces organisations. Dans le cadre de la décision EX.CL/Dec.329 (X), les États membres de l’UA ont décidé que le siège du FMA serait à Yaoundé, au Cameroun. Dans le cadre de la décision Assembly/AU/Dec.64 (IV), les États membres ont décidé que le siège de la BAI serait situé en Libye, et la même décision a proposé que le siège de la BCA soit situé à Abuja, au Nigéria.
L’Acte constitutif de l’Union africaine (UA) adopté lors du 36e Sommet de l’OUA tenu à Lomé au Togo en juillet 2000, a complété l’architecture financière de la CEA avec la création de deux institutions financières supplémentaires (IFSU) : le Fonds monétaire africain (FMA) et la Banque africaine d’investissement (BAI). Dans le contexte des articles 6 et 44 du Traité instituant la Communauté économique africaine (Traité d’Abuja) et de l’article 19 de l’Acte constitutif de l’Union africaine, on souligne respectivement la nécessité de « l’établissement d’une Union monétaire africaine à travers l’harmonisation des zones monétaires » et de « la création des trois institutions financières africaines de l’UA, à savoir la Banque centrale africaine (BCA), le Fonds monétaire africain (FMA) et la Banque africaine d’investissement (BAI) ». Les institutions financières africaines sont particulièrement cruciales et essentielles pour que le continent africain puisse financer son propre programme de transformation en vue de parvenir à un développement durable. Le financement du développement de l’Afrique nécessite des financements substantiels et le rôle des institutions financières africaines à cet égard ne peut être sous-estimé. Il convient de souligner que les sources traditionnelles de financement telles que l’APD et l’IDE n’ont cessé de diminuer au fil des ans. Les dirigeants africains ont reconnu l’importance de mobiliser des ressources nationales pour financer le développement du continent, en particulier l’Agenda 2063 de l’Union africaine.
A cet égard, l’UA a défini plusieurs stratégies de mobilisation des ressources nationales dans le plan de financement de l’Agenda 2063, notamment les instruments de financement existants et nouveaux. Les AUFI permettront d’améliorer la capacité des États africains, mais aussi des CER de financer des projets de développement et de tendre vers une véritable maîtrise de la politique monétaire sur le continent à travers un cadre spécifiquement africain. Ainsi, ces institutions, si elles sont correctement dotées en ressources, pourraient être les véritables moteurs et ferments de l’émergence économique et de l’indépendance financière des États et organisations africaines telles qu’envisagées dans le cadre de l’agenda 2063. En ce qui concerne le progrès vers leur création, certaines avancées, bien que lents, ont été enregistrés. Compte tenu de l’importance des institutions financières en tant que catalyseurs de la mobilisation des ressources nationales pour le développement du continent, des efforts ont été déployés pour accélérer les progrès réalisés.
La nomination de S. E. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo comme Champion pour la création des institutions financières de l’UA lors du 33e Sommet de l’UA qui s’est tenu en février 2020 a été particulièrement significative. Le rôle du Champion est de sensibiliser et de plaider en faveur de la création des AUFI, en vue d’accélérer leur mise en œuvre. La Banque centrale africaine (BCA), qui s’inscrit dans la vision de l’Agenda 2063, devrait voir le jour d’ici 2034. Son rôle est de « développer une politique monétaire commune et une monnaie unique africaine comme moyen d’accélérer l’intégration économique telle qu’envisagée dans les articles 6 et 44 du Traité d’Abuja ». Son but est de jouer le véritable rôle d’une banque centrale. Plus concrètement, cette institution devrait œuvrer à la création et à la gestion de la monnaie unique du continent, mais aussi à (1) promouvoir la coopération monétaire internationale par le biais d’une institution permanente ; (2) promouvoir la stabilité des changes et éviter la dépréciation compétitive des taux de change ; (3) aider à la mise en place d’un système multilatéral de paiements au titre des transactions courantes entre les membres et à la suppression des restrictions de change qui freinent la croissance du commerce mondial.
L’Assemblée des gouverneurs de l’Association des banques centrales africaines (ABCA) a adopté la stratégie conjointe CUA-ABCA pour la création de l’ACB, en 2015. En 2016, le CTS ministériel sur les finances, les affaires monétaires, la planification économique et l’intégration l’a ensuite adoptée. Révisée en 2020, la stratégie et le projet de statut et de structure de l’Institut monétaire africain (IMA) ont été adoptés puis soumis au Sommet de l’UA pour examen et adoption en 2021. La prochaine étape consiste à mobiliser des ressources financières pour l’opérationnalisation de l’IMA et à commencer le suivi et l’évaluation des performances du pays dans la mise en œuvre des critères de convergence macroéconomique et du calendrier de l’ACB. Quant au Fonds Monétaire Africain (FMA), il s’inscrit également comme la banque centrale africaine dans la vision de l’agenda 2063 et dans la continuité du plan de Lagos et du Traité d’Abuja. Il a été créé en 2014 par un Protocole et ses fonctions, selon les dispositions du Protocole qui a permis sa création, comprennent : (1) la promotion de l’assistance monétaire et financière aux États membres et la coopération financière entre eux ; (2) agir en tant que chambre de compensation ainsi qu’entreprendre une surveillance macroéconomique au sein du continent ; (3) coordonner les politiques monétaires des États membres et promouvoir la coopération entre leurs autorités monétaires ; (4) promouvoir la stabilité des changes, la convertibilité des monnaies des États parties et éviter les dévaluations compétitives des taux de change, (5) aider au développement d’un système multilatéral de paiement relatif aux transactions courantes des États parties et éliminer les restrictions sur les changes, et (6) mettre temporairement ses ressources générales à la disposition des États parties selon des mécanismes et des garanties adéquats pour corriger leurs déséquilibres de balance des paiements.
Selon la Décision de l’Assemblée de Syrte. Le Fonds monétaire africain a son siège à Yaoundé, au Cameroun. L’Assemblée de l’UA a créé le FMA lors du Sommet de Malabo en juin 2014 avec l’adoption du Protocole et des Statuts portant création du Fonds monétaire africain (voir Assembly/AU/Dec.517 (XXIII)). Le Protocole et les Statuts sont entrés en vigueur 30 jours après leur ratification par 15 États membres. En décembre 2023, douze (12) signatures ont été enregistrées : Bénin, Cameroun, Tchad, Comores, Congo, Ghana, Guinée-Bissau, Guinée, Mauritanie, Sao Tomé-et-Principe, Togo et Zambie. Un seul pays (le Tchad) a déposé son instrument de ratification. Par ailleurs, la CUA et le Cameroun ont signé en avril 2018 un accord de siège du Fonds monétaire africain. Il s’agit d’une institution clé dans l’écosystème financier africain et dont la création devrait même précéder celle de la banque centrale africaine. En effet, en analysant ses différents rôles, elle vise à pallier la forme de marginalisation de l’Afrique sur la scène financière mondiale.
D’abord, l’idée de créer des monnaies régionales suppose également que ces monnaies puissent transcender les problèmes des monnaies nationales ou communes actuelles, caractérisées par leur non-reconnaissance en termes d’échanges internationaux, leur non-convertibilité entre elles et les fortes restrictions aux échanges dans de nombreux pays africains. Une telle institution pourrait donc œuvrer à y remédier. La mise en place des FMA, sans tolérer le laxisme budgétaire et des finances publiques constamment déficitaires, pourrait parvenir à trouver des moyens africains aux problèmes africains en pleine connaissance du contexte, mais tout en faisant preuve d’une certaine rigueur financière. La Banque africaine d’investissement (BAI) dont le Protocole été adopté en février 2009 lors du Sommet de l’UA (Assembly/AU/Dec.212 (XII)), a vu ses Statuts adoptés plus tard en février 2010 (Assembly/AU/Dec.286 (XIV)).
En décembre 2023, vingt-deux (22) signatures des instruments juridiques de la BAI ont été enregistrées : Angola, Bénin, Burkina Faso, Tchad, Côte d’Ivoire, Comores, Congo, République démocratique du Congo, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée-Bissau, Guinée, Libye, Libéria, Madagascar, Niger, Sénégal, Sierra Leone et Sao Tomé-et-Principe, Togo et Zambie. Parmi eux, seuls six ont ratifié ces instruments : Bénin, Burkina Faso, Tchad, Congo, Libye et Togo. La BAI est considérée comme le véritable outil clé de financement du développement en Afrique et qui répondra aux besoins stratégiques des États et des différentes régions du continent. Selon ce protocole, la Banque a pour fonctions : (1) de promouvoir les activités d’investissement des secteurs public et privé destinées à faire progresser l’intégration régionale des États membres de l’UA ; (2) d’utiliser les ressources disponibles pour la mise en œuvre de projets d’investissement contribuant au renforcement du secteur privé et à la modernisation des activités et des infrastructures du secteur rural ; (3) de mobiliser des ressources sur les marchés de capitaux à l’intérieur et à l’extérieur de l’Afrique pour le financement de projets d’investissement dans les pays africains ; (4) de fournir l’assistance technique dont les pays africains pourraient avoir besoin pour l’étude, la préparation, le financement et l’exécution de projets d’investissement. Il s’inscrit pleinement dans la perspective de construire une véritable intégration économique basée sur le déploiement de projets d’envergure comme l’envisagent les articles 6 et 44 du Traité d’Abuja.
Enfin la Bourse panafricaine des valeurs mobilières (PASE) : Dans un effort pour accélérer l’intégration des bourses africaines, la CUA et l’Association des bourses africaines des valeurs mobilières (ASEA) ont finalisé la négociation d’un protocole d’accord. La CUA souhaite inciter les membres de l’ASEA à s’appuyer sur le projet de liaison des bourses africaines (AELP), afin d’intégrer les marchés des valeurs mobilières et des capitaux sur le continent. Les deux parties ont convenu de travailler ensemble à la création de la PASE. En outre, la CUA et l’ASEA prévoient d’organiser une conférence virtuelle avec les institutions financières, le secteur privé, ainsi que toutes les parties prenantes concernées, pour soutenir la lutte contre la COVID-19 et fournir des solutions globales à court, moyen et long terme pour renforcer la mobilisation des ressources sur le continent. En résumé, les progrès sont lents dans la mise en place de ces institutions financières en raison du faible nombre de signatures et de ratifications des instruments juridiques établissant l’AIB et l’AMF, et des contraintes budgétaires qui entravent la mise en place et le démarrage des travaux sur l’AMI.
L’Afrique perd beaucoup de milliards par an dans les flux financiers illicites. Comment la commission de l’UA réfléchie-t-elle à éradiquer ce fléau puis une question subsidiaire parlez-nous également des financements innovants en vue de financer l’UA avec des fonds propres ?
L’impact des flux financiers illicites peut être largement ressenti dans différents secteurs d’un pays et entraver son développement et sa croissance économique. Par exemple, les flux illicites privent les pays africains de revenus, entravent la croissance économique, contribuent au cycle de la pauvreté sur le continent et ont un impact négatif sur les objectifs de développement substantiels. En tant que tel, les flux financiers illicites sont devenus un facteur préoccupant car ils constituent un obstacle à la réalisation d’une croissance économique durable pour les États africains. La lutte contre les flux financiers illicites est une question de survie pour les écosystèmes financiers africains car ils affaiblissent la mobilisation des ressources nationales et retardent le développement d’infrastructures critiques, de services sociaux et d’autres biens publics essentiels.
Par conséquent, les États africains ne parviennent pas à générer les revenus dont ils ont tant besoin pour financer leur développement, réduire la pauvreté et fournir des services de base à leurs citoyens. Non seulement un État africain particulier ressent l’impact des flux financiers illicites, mais ces impacts s’étendent également à ses partenaires internationaux et au marché mondial dans son ensemble. Le mouvement de fonds hors d’Afrique est susceptible de créer des inégalités mondiales, de déstabiliser la bonne gouvernance et d’affecter les objectifs des projets de développement. En outre, les flux financiers illicites créent une grave instabilité car ils constituent une menace pour la sécurité nationale et internationale, car les fonds illicites peuvent être utilisés pour financer des activités criminelles et le crime organisé. Selon le rapport du Groupe de haut niveau sur les flux financiers illicites (FFI) en provenance d’Afrique, la valeur totale des flux financiers illicites agrégés est passée de 4 milliards USD en 1990 à 50 milliards USD en 2015. La CNUCED (2020) estime que les fausses facturations commerciales se situent entre 30 et 52 milliards USD par an, tandis que la fuite des capitaux est estimée à 88,6 milliards USD par an (Figure 15).
La note conceptuelle de l’Union africaine sur la conférence panafricaine sur la lutte contre les FFI en Afrique prévoit que « les FFI sont concentrés dans des secteurs à forte valeur ajoutée tels que le pétrole, le gaz et les minéraux précieux. Il est donc un fait que les pays orientés vers l’exportation sont plus exposés aux flux sortants des FFI. Les FFI étant un obstacle majeur à la croissance économique et aux efforts de développement, il est essentiel de s’attaquer à leurs effets pour tirer pleinement parti de l’intégration financière de l’Afrique. L’union monétaire continentale africaine a le potentiel de renforcer le commerce intra et interafricain, de stimuler le développement économique et de promouvoir la coopération et l’harmonisation, mais les FFI et leurs effets entravent fortement ces avantages.
Ainsi, la réalisation des avantages découlant de l’union monétaire continentale africaine dépend fortement de la prise en compte active des FFI et de leurs impacts. D’un point de vue strictement financier, les FFI sapent les efforts visant à développer une monnaie unique car ils favorisent la corruption, l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent. En outre, la fuite de capitaux résultant des FFI, comme mentionné ci-dessus, prive les membres des revenus dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs de développement. Néanmoins, il existe plusieurs moyens d’atténuer les effets des FFI. L’un des moyens de lutter contre les FFI et les activités connexes consiste à renforcer les politiques réglementaires qui s’attaquent au blanchiment d’argent, à la corruption et à la mauvaise gestion fiscale. Cela peut être réalisé en améliorant la transparence et la responsabilité, en améliorant les capacités des organismes de réglementation et en promouvant la coopération aux niveaux régional et international. En outre, le problème des FFI peut être résolu en renforçant l’intégration régionale, car cela permettrait un accès facile au partage d’informations, à l’harmonisation des politiques et à l’accès aux enseignements tirés et aux meilleures pratiques. De telles solutions sont également liées à la promotion et à la réalisation d’une Afrique pleinement intégrée financièrement, car une union monétaire continentale exige, entre autres, la coopération et l’intégration, l’harmonisation des cadres réglementaires et la facilitation des échanges. Il est donc vain de promouvoir et de développer une union monétaire continentale sans s’attaquer au problème des FFI et à ses effets, car cela aurait pour conséquence de saper les efforts en faveur d’une union financière continentale.
Les organisations publiques et les institutions panafricaines jouent un rôle crucial dans le parcours de création de la monnaie commune où la dimension politique a une influence significative. En outre, la dynamique internationale, illustrée par des initiatives comme celles des BRIC, influence-t-elle ce paysage ?
Le Comité technique spécialisé (CTS) sur les finances, les affaires monétaires, la planification économique et l’intégration, composé des ministres des finances/du budget, de la planification économique et de l’intégration et des gouverneurs des banques centrales africaines, a pour objectif de discuter, de formuler des recommandations et de superviser la mise en œuvre des recommandations visant à transformer l’Afrique. Ce CTS est également chargé de suivre la mise en œuvre du programme d’intégration du continent, qui comprend l’intégration monétaire et financière. Dans le but d’assurer une intégration financière africaine efficace, les gouverneurs des banques centrales africaines, par l’intermédiaire du Secrétariat de l’Association des banques centrales africaines, supervisent le respect et la mise en œuvre des critères de convergence macroéconomique du Programme de coopération monétaire africaine (PCMA).
Le PCMA implique l’adoption de mesures de politique collectives pour parvenir à un système monétaire harmonisé et à une institution de gestion commune. Il envisage l’harmonisation des programmes de coopération monétaire des différents groupements sous-régionaux comme éléments constitutifs dans le but ultime de développer une zone monétaire unique avec une monnaie commune et une banque centrale commune au niveau continental. Il est donc essentiel que les ministres du CTS et les gouverneurs des banques centrales travaillent en étroite collaboration avec les communautés économiques régionales (CER) – les piliers de l’intégration continentale – afin de garantir que les critères de convergence macroéconomique des CER et de l’AMCP soient alignés efficacement et mis en œuvre en conséquence. Comme indiqué précédemment, la création des banques centrales africaines conformément à l’article 19 de l’Acte constitutif de l’Union est une autre étape vers l’union monétaire.
L’idée de la création d’une monnaie commune entre les membres du BRICS a le potentiel d’avoir un impact positif et négatif sur les membres de l’UA, mais en particulier, l’intégration financière africaine sera confrontée à certains défis. La coopération au sein du BRICS, une institution qui pourrait éventuellement inclure plus d’un pays africain, est censée entraîner des effets positifs globaux entre les pays membres en particulier, mais aussi pour le continent africain en général. Cependant, des effets potentiellement négatifs inattendus peuvent survenir et donner une évaluation différente du projet global. L’établissement d’une monnaie commune aurait des effets profonds sur le commerce et l’intégration de l’Afrique du Sud, de l’Égypte et de l’Éthiopie. Une telle évolution créerait des opportunités pour d’autres États membres de l’Union africaine (UA), en particulier ceux qui ne font pas partie de l’alliance BRICS, d’élargir leurs relations commerciales non seulement avec l’Afrique du Sud, l’Égypte et l’Éthiopie, mais aussi avec les autres membres du BRICS.
Cette expansion serait facilitée par une taille de marché accrue et des réductions tarifaires. En outre, une monnaie commune attirerait probablement davantage d’investissements et de flux de capitaux dans les trois pays africains, contribuant ainsi de manière significative au développement économique, aux projets d’infrastructure et aux efforts d’industrialisation alignés sur les objectifs des organisations et stratégies de l’UA telles que l’Agenda 2063, le PIDA et le BIAT, entre autres. En outre, l’adoption d’une monnaie commune aurait le potentiel d’établir une plus grande stabilité monétaire et de réduire la volatilité des devises en Afrique du Sud, en Égypte et en Éthiopie, attirant ainsi les investisseurs étrangers et renforçant la confiance dans les transactions transfrontalières.
En fin de compte, cela profiterait aux pays africains ayant des liens économiques plus forts avec ces pays et d’autres membres du BRICS. Si l’instauration d’une monnaie commune au sein des BRICS apporte des avantages considérables qui s’étendent aux États membres de l’UA, il est tout aussi important de reconnaître les effets négatifs potentiels qui pourraient en découler. Si la monnaie commune des BRICS prenait de l’importance, il y aurait une possibilité que les monnaies régionales africaines soient supplantées, ce qui pourrait à son tour créer des obstacles potentiels pour les nations africaines. Le remplacement des monnaies régionales pourrait conduire à une réduction de l’indépendance dans la gestion des politiques monétaires de ces pays. Par conséquent, la gestion de leurs conditions et objectifs économiques particuliers pourrait devenir plus complexe et multiforme. La capacité à adapter les politiques monétaires à leurs circonstances particulières pourrait être compromise, ce qui pourrait entraver leur capacité à répondre efficacement aux fluctuations économiques, à stimuler la croissance économique et à poursuivre les objectifs de développement souhaités.
L’abandon de l’autorité sur les politiques monétaires pourrait imposer des limites à la flexibilité et à l’adaptabilité nécessaires pour relever les défis économiques et saisir pleinement les opportunités. Les États membres de l’UA pourraient rencontrer des obstacles pour préserver leur compétitivité si leurs monnaies ne sont pas intégrées dans le cadre de la monnaie commune. Cette situation pourrait rendre leurs exportations relativement plus chères, ce qui aurait une influence sur leur balance commerciale et leur position sur le marché, en particulier en ce qui concerne l’Afrique du Sud, l’Égypte et l’Éthiopie (aux côtés d’autres pays BRICS). Les autres États membres de l’UA seraient contraints de coordonner soigneusement leurs politiques macroéconomiques pour les harmoniser avec la zone monétaire commune. Cela nécessite des modifications potentielles des politiques budgétaires, des cadres monétaires et de la gestion des taux de change pour assurer la cohérence avec le système monétaire commun établi.
Cela serait particulièrement vrai pour les zones monétaires régionales concernées telles que la zone monétaire de l’Union douanière d’Afrique australe (SACU), car elle adhère aux politiques et à l’administration de la Banque de réserve sud-africaine. Par conséquent, l’établissement d’une monnaie commune au sein du bloc BRICS se répercuterait sur l’ensemble de la zone monétaire de la SACU, entraînant des ajustements complexes et contraignants et alignant en conséquence les pratiques monétaires des nations participantes. Les États membres de l’UA, en particulier ceux situés dans la zone de l’Union douanière d’Afrique australe (SACU) et en Afrique subsaharienne, pourraient être confrontés à une vulnérabilité accrue aux chocs économiques externes provenant d’Afrique du Sud par le biais du système monétaire commun des BRICS.
L’établissement d’une monnaie commune entre les pays BRICS pourrait conduire à une interconnexion et une interdépendance accrues, ce qui signifie que des ralentissements économiques ou des crises financières au sein des pays BRICS, en particulier en Afrique du Sud. De tels chocs extérieurs pourraient se manifester par une baisse de la demande d’exportations, une réduction des investissements directs étrangers ou des perturbations des flux de capitaux, ce qui pourrait à son tour mettre à rude épreuve la santé budgétaire, les taux d’emploi et le bien-être économique général de l’Afrique du Sud, ce qui pourrait à son tour se propager rapidement au continent africain, impactant la stabilité macroéconomique du reste des États membres de l’UA. Il est essentiel que les décideurs politiques et les acteurs économiques en Afrique soient conscients de ces risques potentiels et élaborent de manière proactive des stratégies pour atténuer les impacts négatifs de l’influence économique émanant de l’Afrique du Sud dans le cas d’un accord de monnaie commune des BRICS. Bien que le concept d’une monnaie commune des BRICS comporte à la fois des effets positifs et négatifs, il est impératif de souligner brièvement ses ramifications potentielles sur la trajectoire de l’intégration financière en Afrique. L’adoption de la monnaie commune par l’Afrique du Sud, l’Égypte et l’Éthiopie dans le cadre des BRICS ouvre des perspectives prometteuses pour favoriser l’intégration financière africaine.
En premier lieu, la mise en place réussie de la monnaie commune a la capacité de faciliter les flux commerciaux et d’investissement entre les pays BRICS et l’Afrique, favorisant ainsi une activité économique accrue et une intégration plus poussée au sein du continent. En outre, comme mentionné précédemment, l’adoption d’une monnaie commune a le potentiel d’atténuer la volatilité des taux de change, un obstacle courant qui entrave les transactions commerciales et d’investissement fluides. En réduisant cette volatilité, la monnaie commune contribuerait à créer un environnement plus propice à une coopération et une collaboration économiques durables entre l’Afrique du Sud, l’Égypte, l’Éthiopie (ainsi que les pays BRICS) et d’autres pays africains. Deuxièmement, la participation des trois pays africains au projet de monnaie commune des BRICS offre une occasion unique de synchroniser les efforts d’intégration financière africaine avec l’évolution du cadre financier mondial. L’Afrique du Sud, l’Égypte et l’Éthiopie, situées à l’intersection de l’Union africaine et des BRICS, jouent un rôle central dans la réduction du fossé entre les pays BRICS et les autres pays africains. En tirant parti de leur position stratégique, ces trois pays peuvent défendre efficacement les intérêts de l’UA, favoriser l’inclusion et contribuer activement à la conception et à la mise en œuvre de l’initiative de monnaie commune. Un tel engagement s’aligne parfaitement sur les objectifs généraux de l’UA, notamment la réalisation de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), facilitant ainsi un processus d’intégration harmonieux qui donne la priorité à la prospérité collective des nations africaines. En outre, le projet de monnaie commune envisagé par les BRICS a le potentiel de cultiver une coopération financière renforcée et la diffusion des connaissances entre l’Afrique et les pays BRICS.
En guise de conclusion quel sera votre dernier à l’endroit de nos lecteurs puis dites nous pourquoi avoir choisi ce moment précis pour écrire un livre sur la création de la monnaie commune africaine ?
La trajectoire de l’intégration régionale s’est accélérée en avril 2018 lorsque les chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine ont approuvé à l’unanimité la création de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) effective depuis le 1er janvier 2021. Par ailleurs, la nécessité des financements des projets phares de l’Agenda 2063 dont, entre autres, le Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA), le Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine (PDDAA) et le Programme de réduction accélérée de la mortalité maternelle en Afrique (CARMA) tombent à pic pour réexaminer la question des institutions financières africaine particulièrement cruciales et essentielles pour que le continent africain puisse financer ses propre programmes de transformation en vue de parvenir à un développement durable.
Le financement du développement de l’Afrique nécessite des financements substantiels et le rôle des institutions financières africaines à cet égard ne peut être sous-estimé. Les AUFI permettront d’améliorer la capacité des États africains, mais aussi des CER de financer des projets de développement et de tendre vers une véritable maîtrise de la politique monétaire sur le continent à travers un cadre spécifiquement africain. Ainsi, ces institutions, si elles sont correctement dotées en ressources, pourraient être les véritables moteurs et ferments de l’émergence économique et de l’indépendance financière des États et organisations africaines telles qu’envisagées dans le cadre de l’agenda 2063. Le débat sur le francs CFA; les efforts récents des pays de l’Alliance Etats du Sahel (AES) ainsi que l’essor des nouvelles technologies qui présentent à la fois des défis et des opportunités pour l’intégration financière, créent des perspectives intéressantes à la discussion. Cependant, avant de débattre de la volonté politique, des stratégies et des politiques aux niveaux continental, régional et national, il est impératif et tout aussi essentiel de revoir la reconstruction de la conscience africaine comme facteur clé pour favoriser un environnement propice à l’intégration effective du continent africain et de ses peuples.
La reconstruction de la conscience africaine, qui doit commencer par la question « Qui sommes-nous ? », doit faire partie intégrante de la vision plus large des dirigeants et des parties prenantes attachés à l’idéal de l’intégration africaine. Cette vision doit également reconnaître les atouts abondants de l’Afrique, notamment ses ressources naturelles et son capital humain, son dividende démographique inexploité, ses vastes terres arables (dont 65 % restent inutilisées), son environnement propice à l’innovation et son patrimoine culturel extraordinairement riche. Un effort qui libérera un sentiment d’afro-optimisme, déclenchant un sentiment plus fort d’auto-résilience qui refaçonne les perceptions de soi-même et de l’Afrique dans son ensemble, incarnant l’essence du paradigme africain dynamique et égocentrique.



